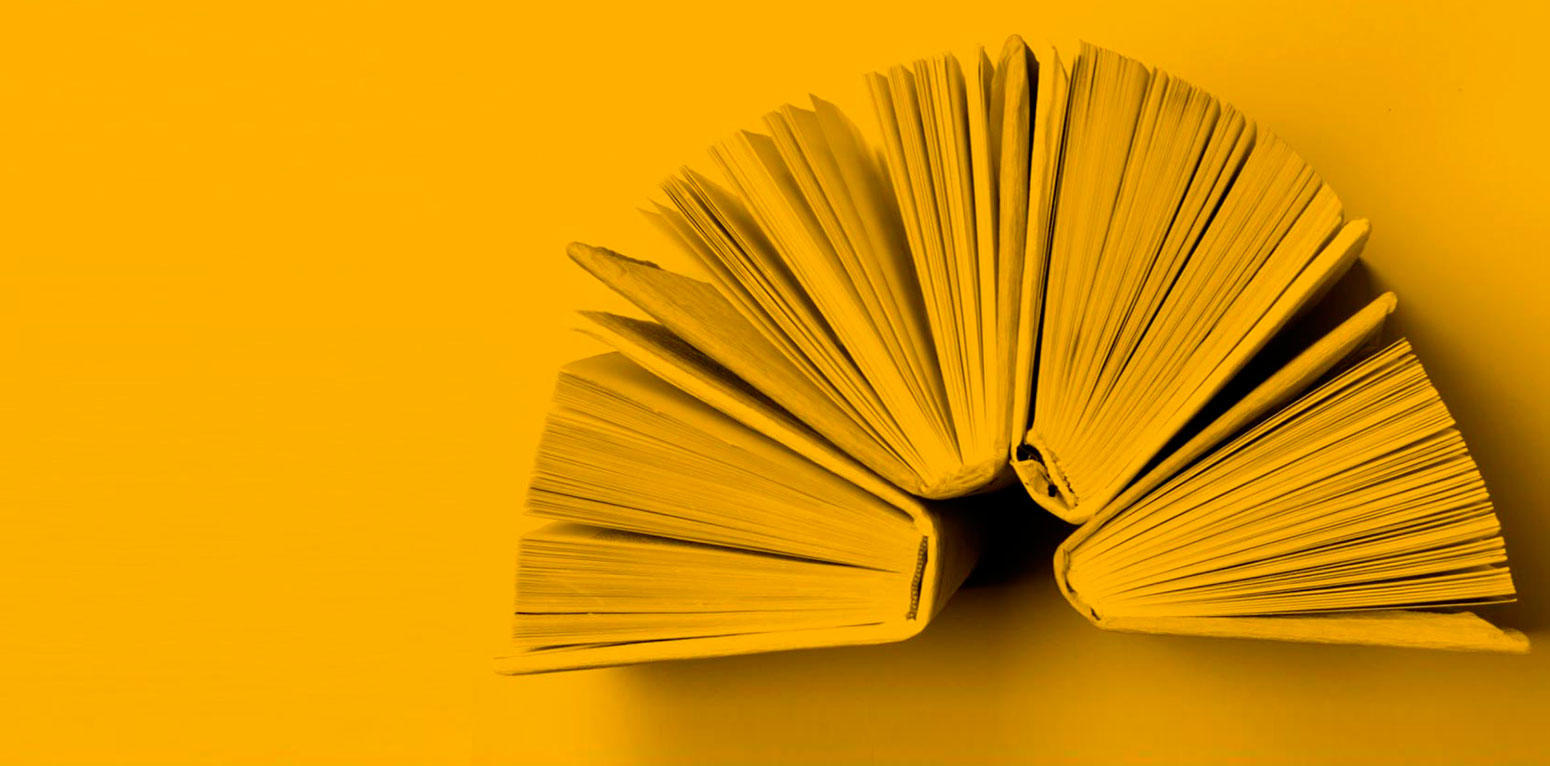" Shakespeare et le poète français "
- Sélectionné pour : Le Prix Littéraire 2004
Né en 1923 à Tours, d’un père ouvrier-monteur aux ateliers des chemins de fer Paris-Orléans (dont le souvenir n’affleure que tardivement dans les textes du poète), et d’une mère infirmière puis institutrice (dont la figure tutélaire apparaît dans maint essai), Yves Bonnefoy poursuit ses études dans sa ville natale où il entre en classe de mathématiques supérieures. En 1942, il passe son certificat de mathématiques générales à l’Université de Poitiers puis part à Paris, en 1943, sous prétexte de préparer une licence de mathématiques à la Sorbonne. En fait, il a déjà abandonné l’idée de préparer une grande école et décidé de se consacrer essentiellement à la poésie. Cependant, le poète conservera toute sa vie un réel intérêt pour les mathématiques, la logique formelle et l’histoire des sciences.
En 1948, il reprend des études universitaires et suit les cours de Jean Wahl et de Gaston Bachelard. Il passera une licence de philosophie suivie d’un diplôme d’études supérieures sur « Baudelaire et Kierkegaard ».
Entre 1954 et 1956, Yves Bonnefoy entre au CNRS et inscrit comme sujets de thèses « Le Signe et la Signification » et « La Signification de forme chez Piero della Francesca » (sous la direction de Jean Wahl et André Chastel). Il publie alors son premier travail d’histoire de l’art Peintures murales de la France gothique et son premier texte consacré à Baudelaire.
« Yves Bonnefoy, à l’instar de Baudelaire, a poussé au plus haut degré ce "culte des images" qui a été la passion de tant de très grands écrivains – Mallarmé, Proust, Valéry -. Poète de la présence, poursuivant "l’immédiat" dans les choses et la "pureté" dans les mots, il lui arrive d’envier les peintres – que ce soit Poussin, Giacometti ou Morandi – qui font apparaître dans leurs oeuvres "cet immédiat, cette plénitude sensible" dont ils sont comme les prophètes.
A quatre-vingts ans, Yves Bonnefoy s’impose comme l’une des figures majeures des lettres françaises. Il a commencé sa carrière dans le sillage des surréalistes, mais il s’est tôt séparé d’eux, poursuivant sa route singulière, qui mène du Mouvement et de l’immobilité de Douve (1953) aux Planches courbes (2001), de l’étude sur les Peintures murales de la France gothique (1954) aux travaux sur Picasso, Balthus, Mondrian ou Alechinsky, en passant par de nombreux essais sur Baudelaire, Mallarmé ou Pierre Jean
Jouve, la traduction des oeuvres maîtresses de Shakespeare, de Yeats et de Leopardi. » (Robert Kopp) Pour Yves Bonnefoy, « le traducteur, c’est le lecteur absolu, pénétrant dans l’oeuvre qu’il a rejointe en son moment historique », ce pourquoi le poète était parfaitement conscient des difficultés mais aussi de la nécessité de retraduire Shakespeare comme le prouve son essai Shakespeare et le poète français. Il y est sensible à la quasi-absence d’une « traduction à la fois complète et hautement littéraire », restituant au moins « un peu de la substance de son admirable poésie ».
C’est pour les OEuvres complètes publiées par le Club français du livre qu’ Yves Bonnefoy a traduit une série de pièces et de poèmes de Shakespeare : Henry IV, Jules César, Hamlet, Le Conte d’hiver, Vénus et Adonis, Le viol de Lucrèce puis, en dehors de cette prestigieuse collection, Le Roi Lear, Roméo et Juliette, Macbeth, La Tempête, Othello, Comme il vous plaira et Vingt-quatre sonnets. Les traductions de Bonnefoy s’imposent par leur transparence, leur exactitude et leur élan poétique. Pourtant, jamais pleinement satisfait, le poète n’a eu de cesse de reprendre ses traductions donnant un aspect work in progress à son entreprise shakespearienne.
Quant à l’oeuvre poétique d’ Yves Bonnefoy, elle tourne autour d’une interrogation centrale : celle de savoir ce que peut signifier vivre en poésie. Car, la poésie peut s’opposer au désastre et être une voie vers moins de malheur ; la poésie, c’est « changer la vie » autant
que rénover les rapports sociaux : « la poésie, c’est rechercher le contact avec ce que la vie a d’immédiat, dans des rapports avec d’autres êtres qui en deviennent de l’absolu, et cette expérience ne peut se faire qu’en délivrant la parole des systèmes conceptuels qui substituent à cette plénitude possible leurs représentations abstraites. (…) La poésie accorde à l’être le droit à son visage, à sa pensée, à son désir propre. Et c’est bien là le fondement d’un régime démocratique. Car cette reconnaissance de l’autre, c’est tout autant celle de l’autre en nous (…) et s’ouvre ainsi la voie d’un Je universel dont l’horizon est le monde, naturel et même cosmique ».
(Yves Bonnefoy in Le magazine littéraire, juin 2003)