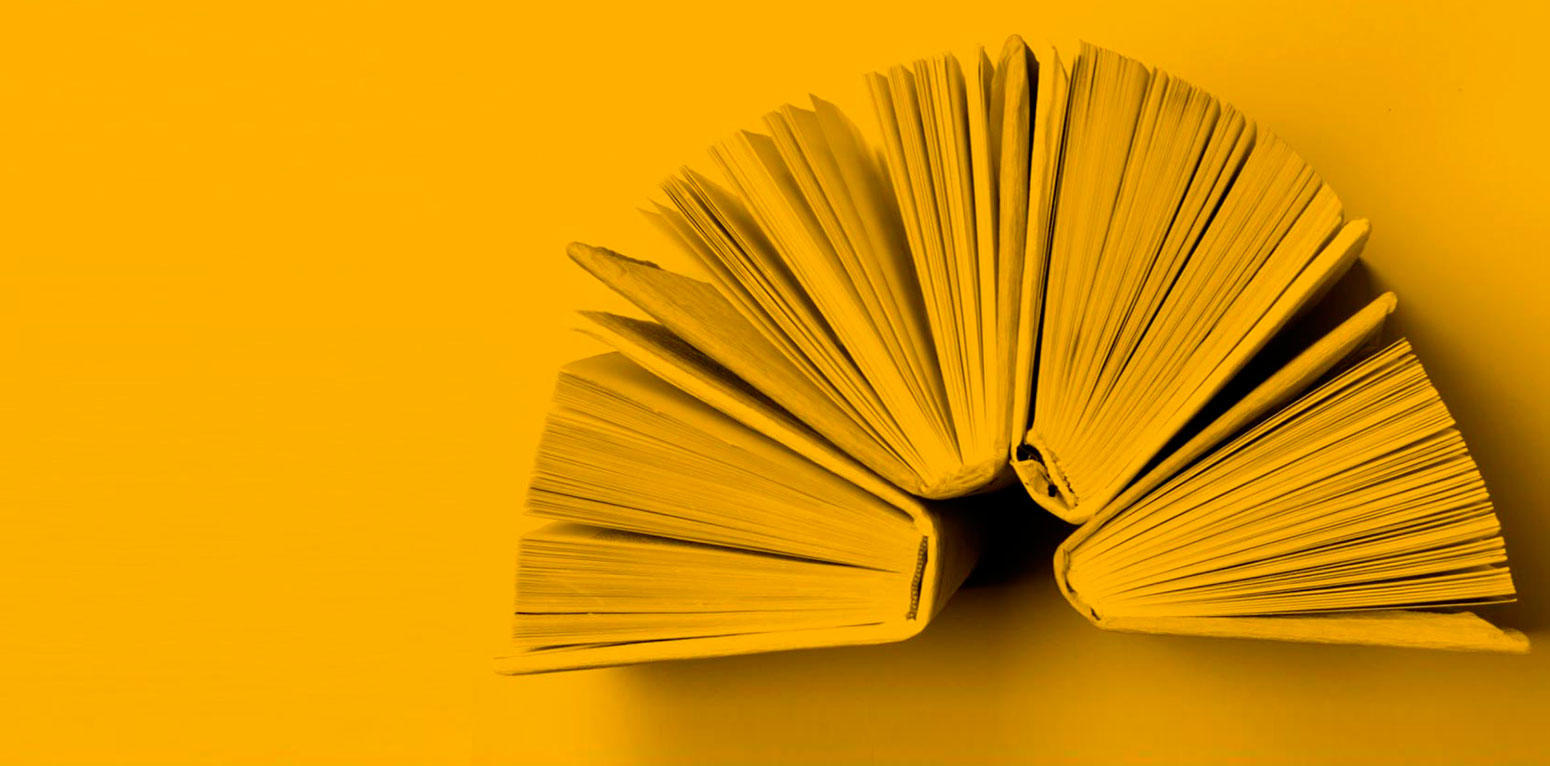" Et, néanmoins "
Roman
- Lauréat : Le Prix Littéraire 2003
Né en 1925, à Moudon en Suisse, Philippe Jaccottet suit des études littéraires à l’Université de Lausanne avant d’entreprendre une collaboration à Paris, de 1946 à 1953, avec l’éditeur Mermod.
Il choisit de s’installer définitivement en France, à Grignan, où il mène dès lors une vie retirée, consacrée à la traduction et à son oeuvre.
Traducteur admirable d’Homère, de Rilke (sans doute l’intercesseur principal du poète) et de Musil, essayiste, Jaccottet est avant tout un poète jusque dans les « proses » et carnets qui jalonnent son itinéraire.
Ses principaux recueils poétiques de 1946 à 1967 – Requiem (1947), L’Effraie (1953), La Promenade sous les arbres (1957), L’Ignorant (1958), Airs, relation poétique des saisons de l’année (1967) – ont été réunis dans un volume de la collection « Poésie Gallimard » en 1971, avec une préface de Jean Starobinski.
Depuis, l’oeuvre s’est diversifiée, offrant des récits de rêves : L’Obscurité et Eléments d’un songe (1961), des proses : Paysages avec figures absentes (1970), A travers un verger (1975) ; des carnets : La Semaison (1971, augmentée en 1984) et Journées (1977).
Dès ses premiers écrits, une obsession de la mort se fait jour : l’« évidence noire » de Requiem (« Toute poésie est la voix donnée à la mort ») et le récit de la mort d’un ami dans Leçon (1969) illustrent cette pensée récurrente. Secrètement miné par le regret et la perte, Jaccottet est parfois tenté par le désespoir du « Maître », personnage de L’Obscurité. Mais, loin de la complaisance morbide, la conscience de la mort chez Jaccottet doit engager le poète dans la voie d’une vie plus ardente et plus noble.
Dès 1974, Chant d’en bas fait appel à une parole plus humble, qui aurait comme intériorisé la « leçon » de la mort. A l’accablement, répond un mouvement vers le haut – A la lumière d’hiver (1977) et surtout Pensées sous les nuages (1983) - où le poète oppose une vision d’équilibre entre la douleur et la beauté de la vie.
En 1990, il publie Cahier de verdure où il mêle vers et proses, multipliant les expérimentations formelles. La sobriété du propos et le lyrisme tempéré sont le reflet d’une morale esthétique où l’humilité est le maître mot : « L’effacement soit ma façon de resplendir ».
En 2002, Philippe Jaccottet revient sur le devant de la scène littéraire : publication de ses correspondances avec Gustave Roud : Philippe Jaccottet, Gustave Roud, Correspondance
1942-1976 (édition établie, annotée et présentée par José-Flore Tappy), Et, néanmoins, recueil de poèmes et de proses poétiques, La Semaison (3ème volume) et Notes du ravin.
« Ici, dans les trois nouveaux livres que nous offre Jaccottet – oeuvres qui semblent surgies d’un très long hiver -, il est de nouveau question d’aubes et de fins du gel, mais il semble que l’espace habité se soit ouvert plus largement, révélant parfois des abîmes. La place laissée aux rêves dans le troisième volume de La Semaison semble ainsi faire reculer l’acte d’écriture vers des zones plus secrètes et inconnues encore » (Laurent Margantin)
Cette impression se confirme dans Notes du ravin : « Le secret du ravin est dans la présence d’une neige très blanche dans un lieu écarté et étroit, et que le poète parcourt et reprend en tout sens. C’est sans doute le lieu premier de la poésie que cherche à pratiquer Jaccottet, un site écorché et silencieux, géographiquement complexe aussi ». (Laurent Margantin)
Et, néanmoins interroge à nouveau : le poétique est-il tributaire des élans ou des chutes du rêve ? Et tel un songe allant du vers à la prose, le poète va du désespoir à l’émerveillement, de l’émerveillement à l’angoisse de la mort dans un mouvement infini.
Mais des surgissements sauvent alors le poète du désespoir, tel le chant du rossignol qui clôt le recueil : « A cinq heures et demie du matin, sorti dans la brume d’avant le jour, j’entends le rossignol, le ruyseñor espagnol, l’oiseau dont le chant est un ruisseau ».