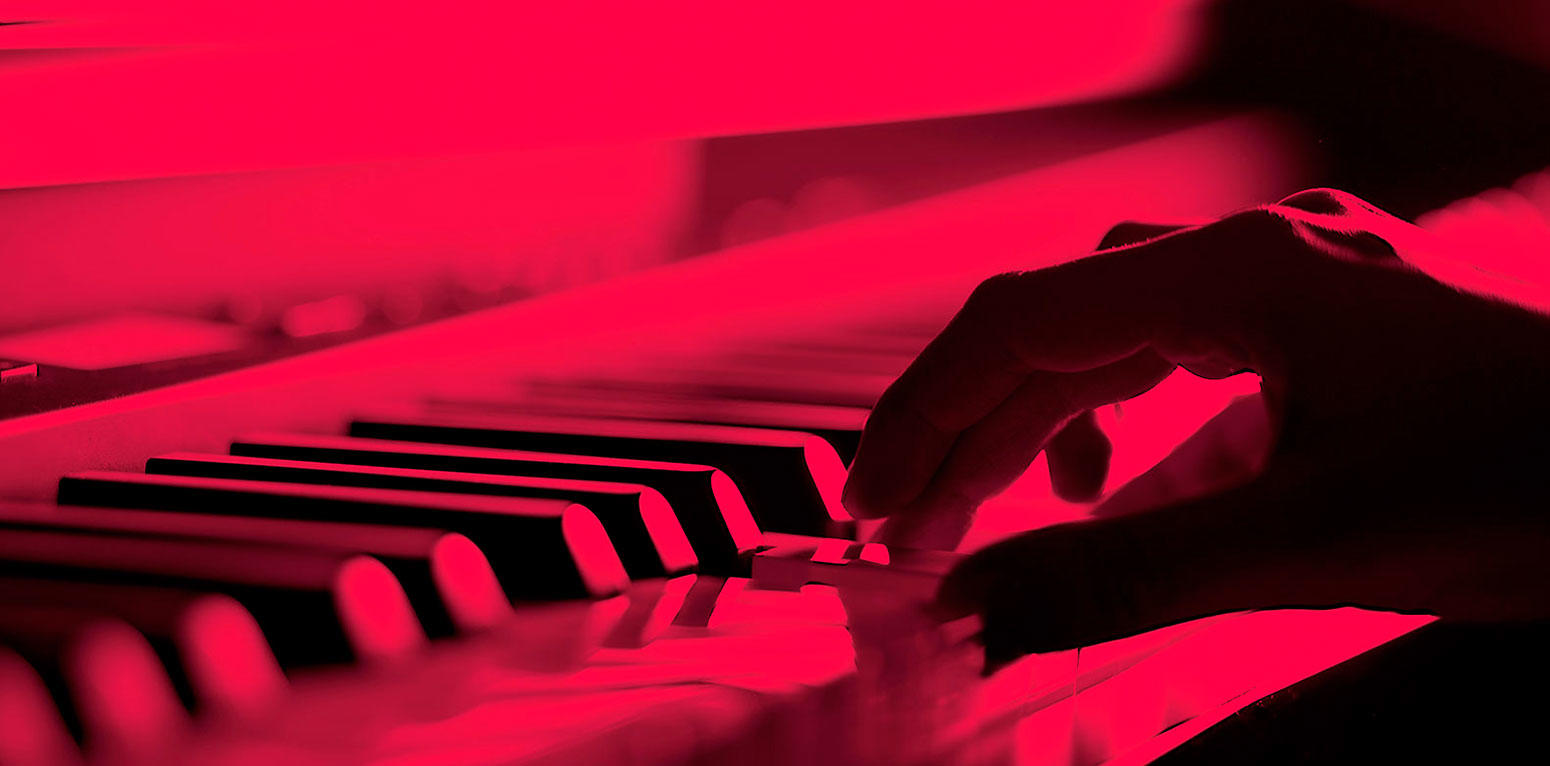" Inedia prodigiosa "
Pour voix de femme, choeur mixte et choeur amateur
SÉLECTION 2019
- Sélectionné pour : Le Prix de Composition Musicale 2021
« Un corps émacié est plus à même de passer par la porte étroite du Paradis, un corps léger ressuscitera plus rapidement, et dans la tombe un corps décharné se préservera mieux. »
Tertullien, De anima (début du IIIe siècle)
L’anorexie féminine est le point de départ d’un projet de théâtre musical dans lequel un groupe de voix de femmes (les femmes du chœur professionnel) représentant les saintes qui jeûnent et les anorexiques de tous les temps apparaît sur scène avec des interventions chorales et solistes. Autour d’elles, un deuxième groupe constitué de voix d’hommes commente, condamne et spécule. Ce sont des hagiographes, des docteurs, des prêtres, des juges, des chefs de famille et des théoriciens qui ont cherché à travers les siècles, en vain, à expliquer les causes de ce phénomène. À une autre place, l’ensemble de jeunes filles est traité comme une source vocale ex machina, symbole du rêve de non-contamination et de pureté partagé par les différents personnages. Le chœur amateur de femmes constitue la passerelle musicale et dramaturgique entre les interprètes et les spectateurs. Ce dernier groupe change de position dans l’espace, migre du public à la scène et génère des effets vocaux complexes. Il représente les territoires de conflit et le contexte atmosphérique des diverses narrations.
Le livret réalisé par Guido Barbieri rassemble des documents, des témoignages, des récits oraux et des transcriptions qui nous parlent de femmes anorexiques à diverses époques et donnent vie à plusieurs personnages. Le matériel textuel pour les hommes, amenés à analyser les positions et les déclarations extrêmes des différentes femmes présentes sur scène, est un collage provenant de différentes sources. Le tout constitue une somme de textes venus d’une multitude d’époques et de lieux, chaque fragment étant conservé dans sa langue originale, comme un livret multilingue et multi-stylistique.
L’ouvrage est divisé en six scènes, chaque scène présentant une jeûneuse en dialogue virtuel avec des docteurs, des prêtres, des observateurs, des physiciens et des juges. Les six scènes sont suivies d’un finale choral rassemblant différentes figures.
Dans la première scène, Mollie Fancher (1848-1916) parle en anglais à la première personne, en contrepoint avec le docteur West, directeur du séminaire de Brooklyn, et le physicien Abram H. Dailey.
Dans la deuxième scène, Anna Garbero, née à Racconigi à la fin du XVIIe siècle, est décrite par le journaliste Domenico Emanuele Govean, tandis que son autopsie est menée par deux docteurs, les professeurs Gallo et Rolando.
Dans la troisième scène, la Française Jeanne Féry (1559-1620) est accusée de possession par le prêtre Pierre Debongnie, soutenu par l’aliéniste Bourneville et le chanoine Mainsent.
Dans la quatrième scène, la noble abbesse Marie-Madeleine de Pazzi (1556-1669) retrace ses extases et ses visions à la première personne en italien, tandis qu’elle se confesse au prêtre Vincenzo Puccini.
Christina Georgina Rossetti (1830-1894) est la protagoniste de la cinquième scène et s’exprime en anglais à travers ses poèmes raffinés, tandis que des passages de L’Anatomie de la mélancolie de Robert Burton soulignent sa solitude volontaire et sa profonde recherche intérieure.
Dans la sixième scène, Anna Maria Kienker, née au début du XIXe siècle, est l’objet d’un témoignage en allemand, écrit par Ludwig Joseph Schmidtmann.
Dans le finale choral, des extraits du blog britannique d’anorexiques Ana sont mis en relation avec des messages d’autres voix féminines et masculines, dans leur langue originale – latin, français, anglais, italien et allemand. Les voix de Thérèse Neumann (1898-1962), Catherine de Sienne (1347-1380), Apollonia Schreier (1607), De Puella Germanica, Martha Taylor (deuxième moitié du XVIIe siècle), Simone Porzio (1496-1554), Gerardus Bucoldianus, Paolo Lentulo, John Reynolds émergent un moment du magma d’idées et d’opinions que complètent les réflexions de deux pionniers de l’anorexia nervosa, William Withey Gull et Ernest-Charles Lasègue, et celles du député Olivier Véran, père de l’amendement Véran sur le poids des mannequins (2015).
Les quatre ensembles chorals – chœur professionnel de femmes, chœur de jeunes filles, chœur amateur de femmes et chœur professionnel d’hommes – sont traités avec différentes textures vocales. Le timbre éthéré et innocent des jeunes filles, symbole de cet espoir d’arrêter le temps, contraste avec l’émission brute et vulgaire du chœur féminin amateur, représentant la parole des femmes refusées et leurs protestations étouffées. Le ton lyrique et délicat des jeûneuses incarnées par le chœur professionnel de femmes tranche avec les voix affirmées et critiques du chœur professionnel d’hommes. Les quatre ensembles vocaux sont en permanence dans une espèce de coprésence stratifiée avec quelques entrées communes sur des pages très connues du répertoire choral, chaque ensemble conservant son caractère vocal spécifique. Le traitement des diverses références et leur adaptation se justifient par la nature expérimentale et la difficulté d’une longue pièce pour chœur seul, sans accompagnement ni soutien instrumental. Pendant plus d’une heure, les quatre chœurs chantent sans pause et dans un contrepoint extrêmement complexe. Les références musicales ont pour fonction d’offrir un moment de respiration, comme une pause active dans un espace musical familier. Après le Sederunt Principes de Pérotin, les chœurs se réunissent dans de courts fragments du Zitti, zitti de Rigoletto, du Hor ch’el ciel e la terra de Monteverdi, du Requiem de Verdi, du Fors seulement de Pierre de la Rue (également cité dans la version d’Ockeghem) en passant par la scène du sommeil de Giasone de Cavalli, Tre volte miagola la gatta tiré de Macbeth de Verdi, Beata Viscera de Pérotin, jusqu’à l’apocalypse des Vêpres de la Vierge de Monteverdi.
Parfois explicites, parfois subliminales, les fresques sonores de différentes époques donnent une couleur caractéristique aux différentes scènes et rappellent la grande arche historique dessinée par le collage de textes. Les citations élaborées créent une union impossible entre les quatre ensembles vocaux, un paysage sonore unifié pour un puzzle fait de différentes voix et de différents styles vocaux.
Lucia Ronchetti
Extrait programme de salle Philharmonie de Paris, fév. 2019