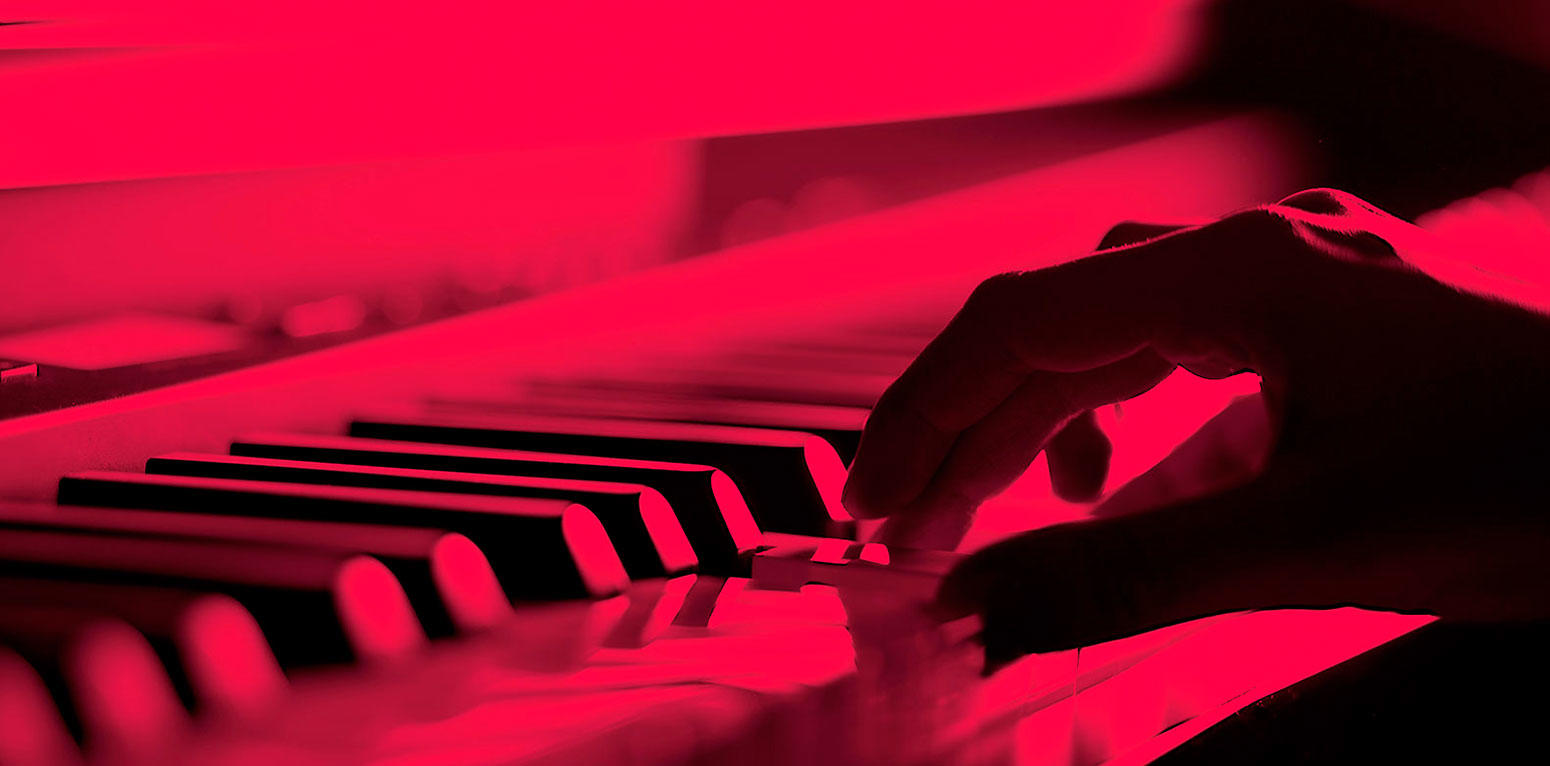" 7ème quatuor "
Pour 23 instruments
Ciels traversés
SÉLECTION 2015
- Sélectionné pour : Le Coup de Coeur des Jeunes Mélomanes 2016
- Sélectionné pour : Le Prix de Composition Musicale 2015
CREATION
24/11/2014 : Radio France - Quatuor Tana : Antoine Maisonhaute, Chikako Hosoda, violons, Maxime Desert, alto, Jeanne Maisonhaute, violoncelle.
NOTICE
SEPT QUATUORS
J’ai composé mes sept quatuors à cordes entre 1998 et 2013.
Les quatre premiers ont été créés avec plus ou moins de bonheur par des ensembles professionnels ou non – le deuxième a été enregistré pour Intrada par le Quatuor Rosamonde – mais c’est le sentiment d’insatisfaction ou de frustration qui a guidé l’écriture des deux suivants.
La rencontre avec le Quatuor Tana s’est déclenchée lors d’un concert au Théâtre Adyar à Paris, le 8 octobre 2012, alors que les deux violons interprétaient des pièces de ma musique de chambre.
J’ai immédiatement eu l’idée de leur confier l’enregistrement de l’intégrale écrite à ce jour en ajoutant un septième - beaucoup plus vaste, complexe et ambitieux - composé spécialement à leur intention d’après les quarante-deux dernières lettres extraites de la correspondance de l’écrivain suisse Robert Walzer, alors interné depuis plus de vingt ans…
Cet enregistrement a été réalisé pendant onze jours sans interruption début novembre 2013 dans la chapelle du château de Chabenet, dans l’Indre, grâce à la prise de son et à la direction artistique de Vincent Mons et d’Antoine Maisonhaute, en ma présence.
LE 7ème QUATUOR
C’est un peu avant Noël 2012 que je me suis procuré la Correspondance de Robert Walser, publiée en français par l’éditeur Zoé de Genève.
Cet écrivain m’était bien connu depuis le début des années 1980 : la lecture de L’Institut Benjamenta et des Enfants Tanner m’avait particulièrement saisi. Sa description d’un monde irréel et merveilleux, apparaît comme séparé de l’existence quotidienne par un rideau opaque.
On perçoit une scission entre ce qu’aime Walser et ce qu’il est, un déséquilibre entre ce qu’il décrit et ce qu’il vit.
Le 19 avril 1928, dans la 221ème lettre des 263 répertoriées, Robert Walser évoque ses cinquante ans et mentionne les vertiges qui l’assaillent de temps à autre. Au fil du temps, ces signes se multiplient et troublent son comportement, au point que sa famille, probablement gênée par une maladie qu’elle ne comprend pas, le fait interner à l’asile d’Herisau, dans le canton de Bienne. (Parenthèse personnelle : ma grand-mère paternelle Laure Lenot-Biétry est née dans ce canton en 1890).
Walser ne dit rien, il continue à écrire des lettres à ses éditeurs et à ses amis pendant vingt-six ans, sans se plaindre. On le croit presque heureux. Etait-il autiste ou schizophrène ? Chaque mot est un indice muet d’une extrême pudeur. A son amie de toujours, Frieda Mermet, il confie sereinement la répétition du quotidien, avec une déconcertante simplicité. (Souvenons-nous de Friedrich Hölderlin enfermé dans sa tour de Tu?bingen, chez Monsieur Zimmer… autour duquel j’ai aussi écrit un certain nombre d’oeuvres).
Ses lettres traduisent pourtant une solitude effroyable et lucide. En exergue à la partition du quatuor, je cite ces mots écrits à son médecin et ami, Carl Seelig, le 28 avril 1939 : « Il est absurde et grossier, me sachant dans un hospice, de me demander de continuer à écrire des livres. La seule terre sur laquelle le poète peut créer est celle de la liberté. »
Il s’installe à la fin de sa vie (1956) dans une sorte de fatalité heureuse, sans résistance. Je me sens proche de ce trait de caractère : j’ai de temps en temps une certitude inébranlable pour une multitude de doutes permanents. En écrivant le quatuor, je me suis aperçu que je dessinais une ligne unique à partir des soli de chaque instrument. Puis ils se rencontrent comme par inadvertance, se coagulent et se séparent. Solos, duos, trios, quatuors : j’ai envisagé 42 configurations pour quatre musiciens. Ces 2 fois 21 moments indépendants peuvent se suivre, se superposer, se compléter comme un jeu de cubes. Ils se répartissent sur deux mouvements pour laisser les interprètes respirer à la césure, ainsi que les auditeurs… J’ai écrit cette oeuvre avec limpidité tout en concevant un monde de détails microscopiques, dissemblables, comme une myriade de souvenirs formant une unité complexe et mouvante.
Je ne connais de la mort de Robert Walser que les photographies de ses derniers instants, prises par la police en arrivant sur les lieux où des enfants avaient découvert son corps. Il est allongé dans la neige, son chapeau derrière lui. Deux taches noires dans l’immensité blanche.
Jacques Lenot