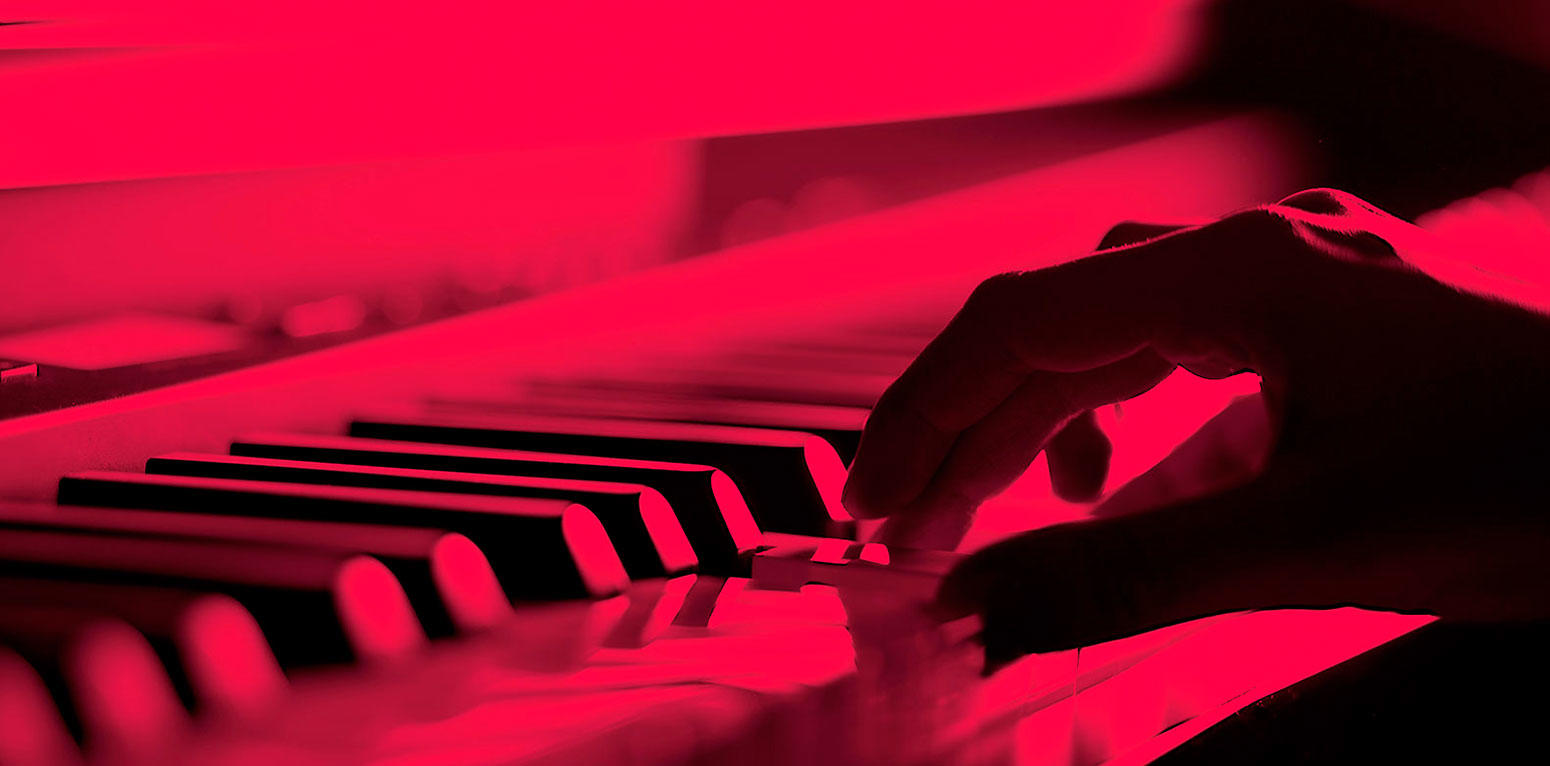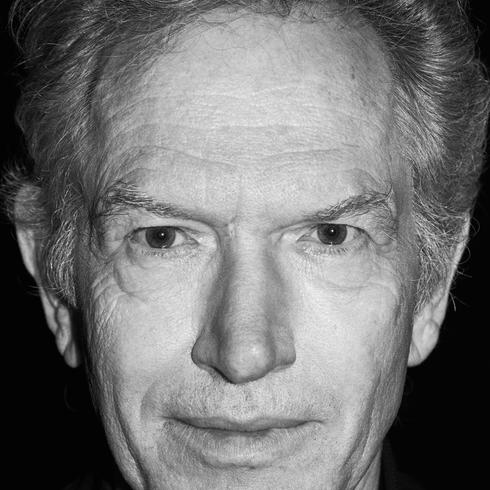© Felix Dol Maillot - Fondation Prince Pierre
En résonance avec la tradition occidentale sous toutes ses facettes, avec les mélodies folkloriques anciennes, la nature, la structure vibrante du son lui-même, la musique de Hans Abrahamsen a cependant la fraîcheur de quelque chose d'intact - d'intact et d'émouvant en tant que tel. Nous sommes dans un monde que nous connaissons en partie. Bach et Ligeti se profilent à l'horizon. Cet air me dit quelque chose. Les souvenirs s'agitent de sons aussi clairs que la lumière. Et pourtant, tout est différent.
Il n'est pas étonnant que ce compositeur soit à l'origine de tant de musiques de neige, car la neige s'inspire de ce que nous connaissons pour offrir la possibilité d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, Abrahamsen l'a réalisé à plusieurs reprises, notamment dans sa Schnee (2006-8), écrite pour deux pianos et percussions avec des trios contrastés, et considérée à juste titre comme l'un des premiers classiques de la musique du XXIème siècle. Les canons qui se cristallisent progressivement, pendant près d'une heure, sont aussi des portraits musicaux de la neige : ses flocons, sa délicatesse, son froid. Bien que basée sur une mélodie modale, la pièce n'est en aucun cas une musique de notes blanches ; en effet, les réaccordages microtonaux caractéristiques, effectués au cours de l'exécution, sont cruciaux pour la façon dont elle sonne, brouillant magnifiquement le contrepoint à mesure que les canons entrent et sortent du champ de vision.
Débutant très tôt – il a publié ses premiers travaux à 16 ans - Abrahamsen a commencé par redécouvrir les fondamentaux. À l'âge de 30 ans, sa production est considérable : plusieurs œuvres orchestrales (Nacht und Trompeten, un nocturne lumineux et dramatique, commandé par la Philharmonie de Berlin), deux quatuors à cordes et de nombreuses autres pièces, essentiellement instrumentales, dont un autre bel exemple de poésie musicale hivernale, Winternacht.
En 1984 paraissait une série de sept études pour piano (portées plus tard à dix), dont certaines, dans leurs processus furieux, anticipaient de manière frappante celles de Ligeti de l'année suivante. Ligeti, qui fut brièvement son professeur, avait été l'un de ses premiers héros, de par l'exactitude et la beauté, avec Steve Reich. La dette a été remboursée et une porte s'est ouverte. Abrahamsen a immédiatement arrangé six des études pour en faire une pièce d'accompagnement pour la première danoise du Horn Trio de Ligeti (un arrangement retravaillé par la suite, avec un violoncelle à la place du cor, sous le titre Traumlieder) ; il a également recomposé quatre des pièces pour grand orchestre.
Mais cela ne s'est produit que 20 ans plus tard. Le chemin menant aux études de piano ne s'est pas avéré si évident, et la productivité d'Abrahamsen s'est ralentie, puis arrêtée. Parallèlement, il trouve un nouveau débouché en tant qu'arrangeur, notamment de pièces de Bach et de Nielsen. Parmi les compositions originales, seule une brève mise en scène de Rilke, Herbstlied, a interrompu son silence entre 1990 et 1998.
Après avoir repris son activité créatrice avec quelques études de piano supplémentaires, il produit sa première grande œuvre depuis 15 ans, le Concerto pour piano qu'il achève en 2000. Ici, et ce n'est pas la dernière fois, un nouveau départ prend de profondes racines dans son passé - dans les ostinatos turbulents et déséquilibrés et les calmes contrastés des études pour piano, et dans la polyphonie de types et de sujets qui remontent à Winternacht et plus loin encore. Le concerto est également tout à fait caractéristique en ce qu'il est à la fois intime et très élaboré, aussi proche de Schumann que de Stravinsky.
Une fois encore, ce qui aurait pu sembler être une percée s'est cependant avéré être une impasse, et c'est alors qu'Abrahamsen se tourne à nouveau vers ses études de piano pour refaire les quatre premières pièces sous le nom de Four Pieces for orchestra (2004). Rivalisant avec Ravel ou Boulez pour la transformation orchestrale, et écrits pour une grande formation comprenant des tubas Wagner et d'abondantes percussions, ces mouvements découvrent dans les originaux pour clavier non seulement des intimités insoupçonnées de sonorités envoûtantes, mais aussi une puissance expressive imprévue.
Le travail d'Abrahamsen en tant qu'orchestrateur ou ré-orchestrateur s'est poursuivi, avec une réduction de la dernière symphonie de Nielsen et un arrangement du Children's Corner de Debussy, maintenant à côté de la séquence de nouvelles œuvres majeures qui a débuté sérieusement avec Schnee. Son Third String Quartet (2008), en quatre mouvements courts, est une pièce relativement simple qui reste profondément déroutante. Il commence par une invention purement diatonique (cela s'était déjà produit dans sa musique, par exemple dans les mouvements finaux de son First Quartet et de son Wind quintet Walden) qui pourrait facilement être une chanson folklorique, et qui semble détenir la clé des mouvements qui suivent - une clé qu'ils ne pourront jamais retrouver.
Ici, les accords microtonaux sont absents, mais ils réapparaissent dans Wald pour quinze musiciens (2009), qui, comme Schnee, est à la fois une représentation naturelle (dans ce cas des forêts ombragées), une évocation culturelle (des appels de cor, des chasses et du mystère qui rôde) et une construction musicale élaborée. Les auto-similarités de la forêt enchevêtrée sont reprises à plusieurs niveaux, de la trémulation d'ouverture (quartes jouées par deux violons, décalées l'une par rapport à l'autre sur le plan microtonal et métrique) à la forme de la variation à grande échelle.
Les quatrièmes désalignées, à la fois inquiétantes et captivantes, du début de Wald reviennent au début de l'œuvre qui a suivi : le Double Concerto pour violon, piano et cordes (2010-11). Il y a aussi des flocons de Schnee, comme les quasi-unions glaciales et exaltantes des harmoniques aiguës du piano et des cordes ou les figures dansantes des deux mouvements rapides. Mais il s'agit aussi d'une œuvre qui a son propre caractère et qui atteint des moments de brillance éclatante ou d'étreinte consolatrice.
Chaque composition rejoint ses compagnons comme une sœur, apparentée mais distincte. Le quatrième quatuor d'Abrahamsen (2012) commence dans un monde glacial d'harmoniques élevées et se termine par une utilisation typique de l'intrication rythmique pour créer une danse irrégulière. Son let me tell you (2013), monodrame pour soprano et orchestre, s'achève à nouveau dans un paysage hivernal mais est peut-être plus remarquable pour sa réinvention de la mélodie vocale, vivement expressive, de la part d'un compositeur qui avait très peu écrit pour la voix. Cette réalisation lui a valu le prix Grawemeyer en 2015.
Son concerto pour piano main gauche, Left, alone (2014-15), est à nouveau un drame, une histoire de conflit, de solitude et d'exaltation communautaire, et prouve qu'il est prêt pour le prochain défi qu'il s'est fixé, celui de l'opéra, sur un sujet fait pour lui : Hans Christian Andersen The Snow Queen.
Wilhelm Hansen
Texte traduit de l’anglais