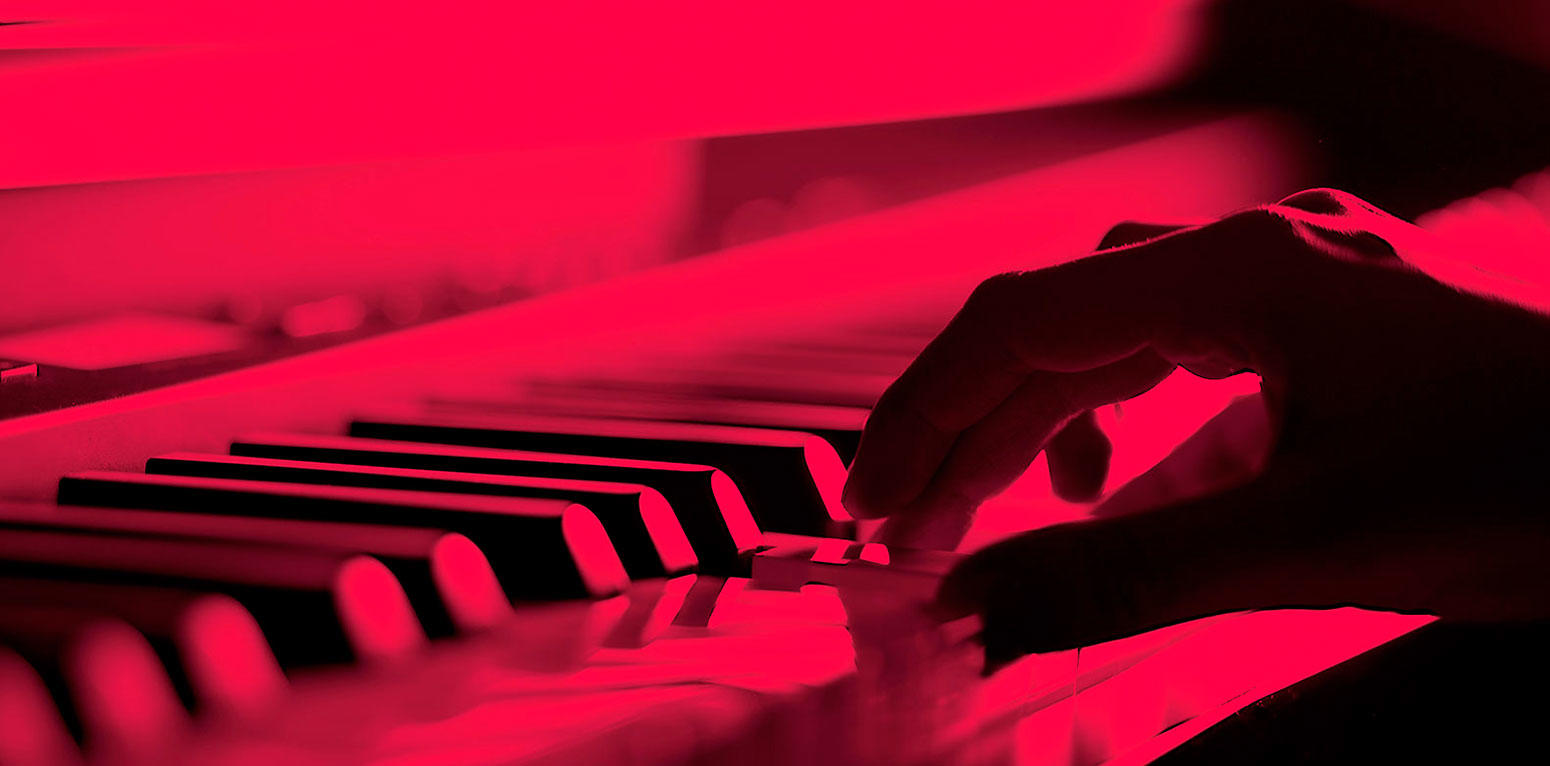" Auf...II "
pour grand orchestre
Editions Peters
- Sélectionné pour : Le Prix de Composition Musicale 2008
(Paris, 1964)
Mark Andre étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris auprès de Claude Ballif et Gérard Grisey. Il y obtient les premiers prix de composition, contrepoint, harmonie, analyse et recherche musicale.
En 1994, à l’École Normale de Paris et au CESR (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance) de Tours, il soutient un doctorat en musicologie intitulé “Le compossible musical de l’Ars subtilior”.
Après trois ans d’étude à la Musikhochschule de Stuttgart, il obtient en 1996 un diplôme de perfectionnement en composition musicale à la Hochschule für Musik de Stuttgart dans la classe d’Helmut Lachenmann. En 1995-1996, il est boursier à l’Akademie Schloss Solitude ; en 1997, en résidence à l’Experimentalstudio de la Heinrich-Strobel-Stiftung, et de 1999 à 2001, pensionnaire à la Villa Médicis à Rome.
Mark Andre a obtenu de nombreux prix de composition internationaux, pour « Fatal », « Un-fini I et II », « Le trou noir univers », « Le loin et le profond ». En 2002, il a reçu le Förderpreis de la Fondation Siemens de Munich pour « Modell ».
Il reçoit des commandes de grands festivals européens (Donaueschingen, Darmstadt, Witten, Münchener Biennale für Musiktheater, Salzbourg…) pour des ensembles tels que l’Ensemble Modern, le Kammerensemble neue Musik Berlin, l’Ensemble Recherche, l’Ensemble Alternance, les Percussions de Strasbourg ou le quatuor Arditti.
En 2005, il est compositeur en résidence à Berlin, au DAAD Künstlerprogramm. En 2006, au cours du Kunstfest de Weimar, lui a été attribué le prix de composition de la Christoph und Stephan Kaske-Stiftung, en 2007 il reçoit le Giga-Hertz-Preis du ZKM et du Studio Freiburg. Mark Andre enseigne le contrepoint et l’instrumentation au Conservatoire National de Région de Strasbourg et à la Musikhochschule de Franckfort.
Mark André par Jean-Noël von der Weid
La musique de Mark André intrigue et éblouit parce qu'elle est opaque et impénétrable. Elle est une musique de l'extrême ; du hors-signifié. Une effraction de l'absence de sens qui torpille toute tentative d'y trouver une immédiate délectation. (…)
Ses oeuvres sont de grandes pages énormes, coriaces et saturées ; bizarrement closes sur leur propre densité. Leur massivité, leurs couleurs sombres (pour l'heure Mark André prédilecte les registres graves) alourdissent chaque note d'un poids pur, larguent néanmoins toute redondance, ne laissent aucune issue à la séduction ni au coq-à-l'âne. C'est une musique comme écorcée mais moelleuse, opiniâtre mais trouée de fulgurances, faite d'élégance à la fois arrêtée et fuyante.
La composition, ce que le compositeur nomme l'« architecture compositionnelle », est aujourd'hui en crise. Il s'agit d'en prendre acte. L'y ont aidé : le système mensuraliste (Francon de Cologne) utilisé dans le corpus de l'ars subtilior à la fin du XIVe siècle, qui, très tôt, le fait réfléchir sur une nouvelle mécanique du temps musical ; des études avec Helmut Lachenmann pour lequel, profonde et singulière, cette architecture se situe entre l'affect et le concept. (« Méditer son exemple, explique Mark André, c'est en quelque sorte être à l'écoute de son propre opus 10. »). Poser la problématique des liens entre l'affect et le concept, entre la discordance et le concordance, c'est structurer l'acte compositionnel lui-même, et être structuré par lui ; c'est également accepter une démarche qui est, « par essence, autocritique et auto-éthique ». Ces liens, Mark André les redéfinit sous la forme d'une «compossibilité» (concept dû à Jean Duns Scot dans son Traité du premier principe) musicale, entre ce qui ressortit au domaine du fini et à celui de l'infini. En émane l'Un-fini (titre d'ailleurs d'un cycle d'oeuvres de Mark André), espèce de zone aveugle, de trou noir, incertitude fondamentale comme aboutissement d'une déconstruction du matériau musical, de sa fragmentation dans l'espace et dans un temps écartelé (…).
NOTICE
« …auf… II » est dédié à Pierre Boulez et aux solistes de l’Ensemble Modern.
Auf...II est le second volet d'un triptyque (...Auf...) dont le propos est de transposer en musique le motif de la résurrection (auferstehung) du Christ. La transition et le seuil, mais aussi le possible passage d'un état à l'autre jouent ici un rôle important.
L’idée sous-jacente était la suivante : comment fonctionne un seuil musical lorsqu’il joue le rôle de transition possible, et comment peut-on le développer ? Dans les décisions qu’Andre a dû prendre dans ce contexte, il s’est toujours fié à son intuition, qu’il considère comme un élément important de son travail de composition. Mais malgré cette référence à l’Évangile, il ne s’agit pas de musique religieuse.
La résurrection du Christ est certes le thème fondamental de son oeuvre, mais elle n’apparaît qu’en arrière-plan, de manière indirecte.
Dans … auf …, sont présentés différents espaces temporels et sonores. L’ouverture de nouveaux espaces sonores par la composition y joue un rôle central. Ce qui importe à Andre, c’est de développer une tension particulière entre différentes impulsions et réponses, par exemple l’harmonie et la disharmonie, chaque impulsion jouant un rôle vital. Le développement conséquent et structuré de ces textures sonores représente l’arc qui surmonte l’oeuvre. Peu à peu, tout se décompose ensuite en fragments, processus autour duquel Andre réussit à développer différentes catégories de silence.