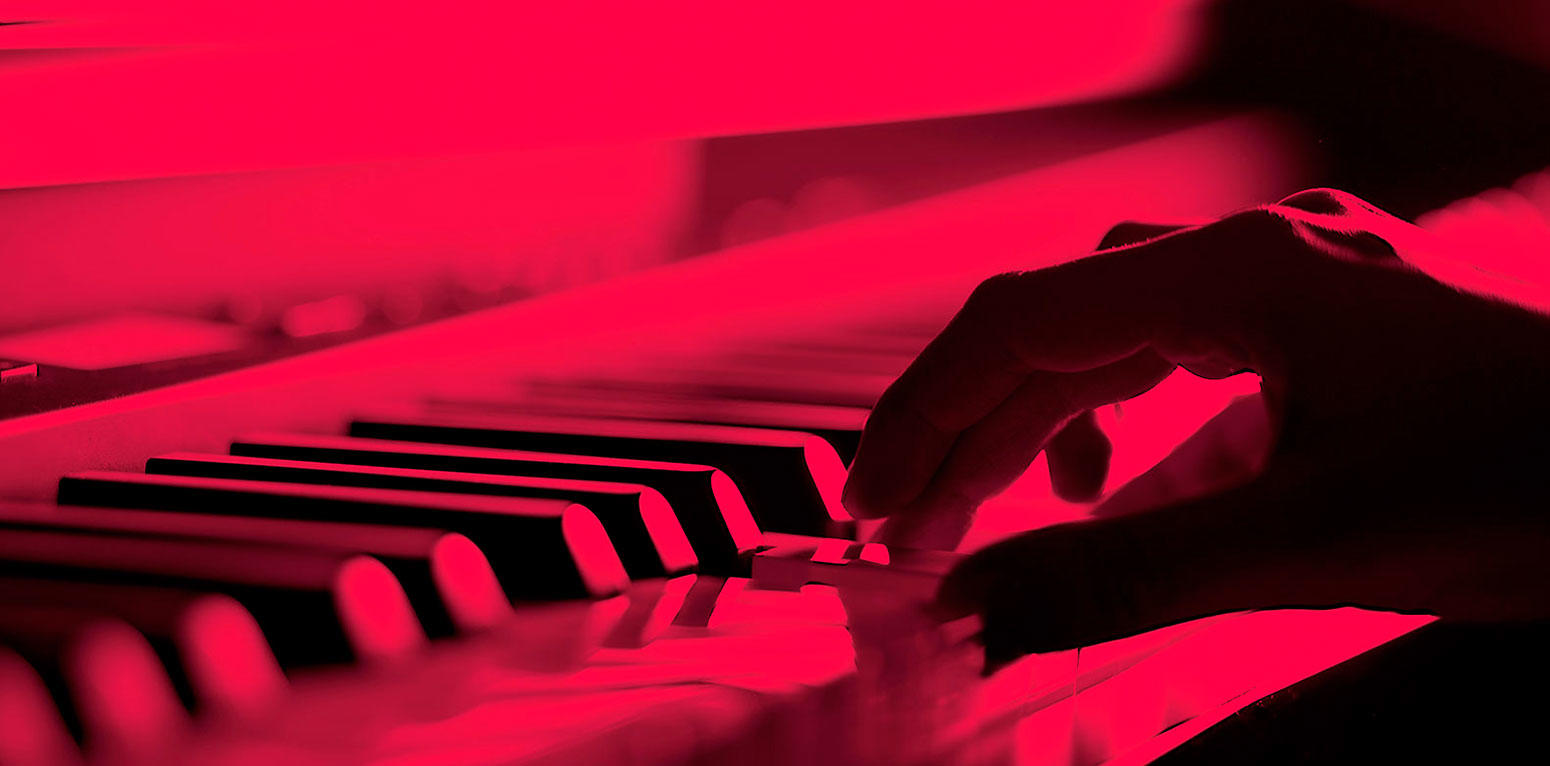Opéra en 8 chapitres
sur un livret original de Frédéric Boyer
d’après Macbeth de William Shakespeare
1h45
> Commande de la Monnaie et l’opéra comique
> Création le 20 septembre 2019 Théâtre Royal de la Monnaie, Bruxelles
Direction musicale, Alain Antinoglu / mise en scène, Thomas Jolly
Orchestre Symphonique et chœur de femmes de la Monnaie
Ces deux-là, c'est le trouble, l'aberration, la violence, le désordre total. Du crépuscule à la nuit, leur histoire se dévoile dans une atmosphère ténébreuse où tout est sombre, opaque, morne et cruel. Les sœurs étranges répètent avec lui : « Beau est noir et noir est beau », elles sont l’oracle, une sorte de diable à trois têtes mais ce sont des fées aussi. Les deux sont habités de démons insensés qui les hantent comme des feux ardents, abandonnés à leurs terreurs funestes. Ils ne savent plus ce qu’ils ont fait mais ils doivent le faire. Tout se passe comme s’ils devaient le refaire ou le rejouer. C’est plus fort qu’eux. Ensemble. Ils confondent tout, l’apparence, la réalité, l’avant, l’après. Ils entendent des voix. Ils ne savent plus ce qui se passe, quelque chose d’ailleurs passe au travers d’eux, leur vision est trouble. Leurs sens s’exacerbent, enflent comme des gorgones avides. Leurs yeux sont ouverts à l’intérieur d’eux, ça les pétrifie mais lui, il doit le tuer. Le roi. En fait, on ne sait plus trop pourquoi, pour devenir roi oui bien sûr, c’est simple à comprendre mais au même instant il a des visions. Le poignard plane et ondoie devant lui comme un oiseau lent. C’est un mirage. Elle, c’est elle qui veut ça, tuer le roi ce bon roi, elle transgresse tout ce qui passe, elle ne comprend rien d’elle, c’est la confusion, elle inverse tout et l’autre tue le roi parce qu’il croit vouloir ça aussi. Il ne pense plus, c’est un faux fort. C’est un fluet. Quand c’est fait, il ne s’en souvient même plus, il a la berlue. Tout à coup, il tue tout autour de lui, c’est irrésistible, il ne peut plus s’arrêter, puis il prend peur, depuis le début il a peur, il a toujours peur, devient délicat, presque douillet, il part en vrille, soudain elle meurt aussi, tout dégénère et devient infâme en lui. A la fin, il le sait, c’est trop tard et c’est fini.
Lorsque j’ai commencé à imaginer un opéra sur ce texte damné, je me suis donc retrouvé un peu comme elle et lui, perdu, apeuré, anxieux, le meurtre en moins certes, mais quand même, un sacré relent de mort aux trousses. J’imaginais à me faire peur. Pourquoi devais-je écrire ça ? Encore une histoire qui finit mal. Mais c’était aussi plus fort que moi. Je n’avais pas fini le précédent opéra - celui où la femme écorche et dévore son homme avec sa bouche rouge ouverte pleine de dents aiguës - que je savais qu’il fallait faire pire. Voilà, et maintenant je l’ai fait. Heureusement, rien n’est vrai. C’est un opéra, comme sont souvent les opéras. Plein d’effroi, alarmé, fragile, cocasse malgré tout et ça chante tout le temps.
Avec un opéra, je ne veux pas raconter une histoire mais tenter de dire le monde comme je l’entends. Comme ça passe devant moi. Il ne s’agit pas de raconter une histoire de plus mais faire plus d’histoires avec l’opéra. Chaque opéra charrie sa peine, son inquiétude, son indescriptible détresse. Ça vient à soi seul. Le texte arrive comme ça, il se tient debout devant vous, c’est fou, c’est comme une adresse à soi-même. D’abord, ça vous toise d’un œil morne, ça dure un moment, longtemps, ça rumine en vous puis ça vous contraint. Alors, il faut dire ça en musique, par la musique parce que c’est comme ça que se fait. Un opéra.
La permanence de l’histoire de ces deux-là ne cesse pas d’accabler notre temps. Ç’en est même effarant comme c’est moderne. C’est une question, au même instant une métaphore et vice-versa. L’opéra c’est dire en chantant ce qui nous préoccupe ensemble. Alors, j’ai lu et relu cette pièce dont on ne dit pas le nom, toutes les traductions (depuis longtemps tout le monde s’y est mis), j’ai vu les films (il y en a beaucoup), les pièces (encore plus, chacun à son idée là-dessus), j’ai lu ce qui s’écrivait dessus, dessous aussi (c’est plein de souterrains, de sous-bois, c’est toujours obscur, on n’y voit rien), j’étais épuisé par ce texte, envahi, perdu. Lorsque j’ai été tout à fait englouti, tout au fond, j’ai demandé à Frédéric Boyer que l’on fasse ça ensemble. Il fallait absolument l’embarquer - lui - dans cette aventure. Alors, il a tout relu aussi, et puis il a tout réécrit. Ça s’est fait comme ça. Mot à mot. Note à note.
Pascal Dusapin / 28 juillet 2018