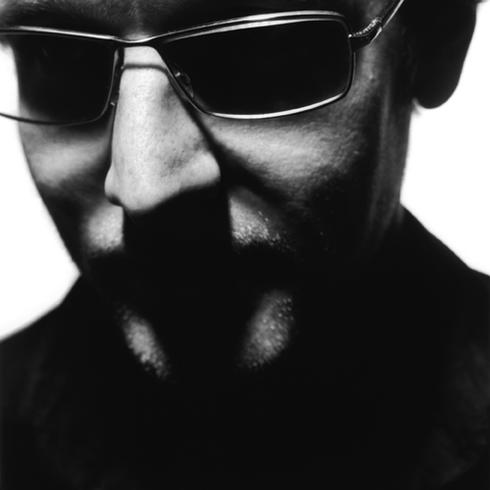" Nummer Twaalf 2009 "
video
Guido van der Werve est né le 7 avril 1977 à Papendrecht, aux Pays-Bas.
Enfant, il apprend le piano classique. Après un cursus au conservatoire de Rotterdam, puis des études de design industriel, d’archéologie classique et de russe, il s’inscrit à l’Académie Gerrit Rietveld en section « arts audiovisuels ».
Il est en résidence à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten en 2006/2007, puis auprès de l’International Studio & Curatorial Program (New York) en 2008. Nominé pour le Prix de Rome néerlandais en 2005, il obtient en 2008 une bourse de la Foundation for Contemporary Arts de New York.
Guido van der Werve fait ses débuts en tant qu’artiste performer. Ne souhaitant toutefois pas réaliser ses performances en direct, il les enregistre. C’est en réalisant ces captations qu’il commence à s’intéresser au cinéma et à la prise de vue.
Les performances constituent le cœur de sa série de films numérotés, mais Guido van der Werve y ajoute des éléments récurrents : musique, textes et scènes d’ambiance. Il travaille à partir de longs plans descriptifs et se refuse à faire appel à des acteurs professionnels. Depuis 2007, il compose ses propres bandes son. De formation musicale, il s’efforce de donner à ses créations dans le domaine des arts visuels l’immédiateté de la musique.
Les œuvres de Guido van der Werve ont été largement exposées dans le cadre d’expositions tant monographiques que collectives, notamment à la Tate Modern de Londres, à la fondation De Appel à Amsterdam, au Stedelijk Museum Bureau d’Amsterdam, au musée De Hallen à Haarlem, au MoMa de New York, au Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Séville, à la Galeria Vermelho à São Paulo, au Centre national d’art contemporain de Moscou, au musée Ludwig à Cologne, à la biennale Manifesta 7, à la Triennale de Turin 2008, à la Hayward Gallery à Londres, à la Royal Academy de Londres, à la Kunsthalle de Bâle ainsi qu’au musée Hirshhorn à Washington.
Nummer Twaalf, 2009
Variations sur un thème
Le gambit du roi accepté,
le nombre d’étoiles dans le ciel
et pourquoi il est impossible d’accorder un piano.
Nummer Twaalf est une installation cinématographique de 45 minutes structurée en triptyque, autour d’une partie d’échecs. Chaque volet du triptyque constitue une variation sur le thème de l’éphémère par opposition au perpétuel. Selon moi, la face éphémère du perpétuel est la mélancolie.
Chacune des scènes a pour point de départ un problème insoluble (ou qui prendrait une éternité à résoudre) inscrit dans un champ noir et blanc : les touches d’un piano, un jeu d’échec et les étoiles dans le ciel. L’insolubilité du problème, et par là même, son infinitude, sont présentées en contraste avec le caractère éphémère de l’environnement dans lequel se déroule le film : dans la première scène, il s’agit de joueurs d’échecs âgés, dont la vie touche à sa fin ; dans la deuxième, du volcan en activité mont Saint Helens ; dans la troisième, de la faille active de San Andreas.
Chaque volet du triptyque est mis en corrélation avec l’une des phases d’une partie d’échecs : ouverture, milieu de partie et finale. La partie jouée pendant le film, et qui constitue son fondement, est une nouvelle variante du gambit du roi accepté, spécialement élaborée pour les besoins de l’œuvre. Pour la mettre au point, j’ai travaillé tout au long de l’année 2008 avec le grand maître Leonid Youdassine. La première scène du film présente l’ouverture de la partie. Dans les deux autres scènes, les mouvements des pièces sont montrés à travers leur notation, qui s’affiche en blanc dans le coin inférieur droit de l’écran.
La bande originale joue un rôle important dans le film. Il s’agit d’une création originale pour piano et cordes que j’ai composée sur la base de la partie d’échecs précédemment décrite. Pour ce faire, j’ai conçu un nouvel instrument, le piano à échecs (cf. photo 1), un échiquier doublé d’un piano mécanique. Les cases du plateau s’enfoncent comme les touches d’un piano, et déclenchent le mécanisme permettant aux marteaux d’aller frapper les cordes. Ce piano à échecs est accordé en fonction de la notation propre aux échecs, soit les lettres a b c d e f g a (et non h) figurant sous la première rangée de l’échiquier. Ces lettres correspondent aux noms des notes (la, si, do, ré, mi, fa, sol, la) dans la notation anglo-saxonne de la gamme de la mineur, et le piano est accordé dans cette tonalité. J’ai consacré plus d’un an à la mise au point de ce piano à échecs.
La première partie du film (ouverture) évoque le nombre de parties différentes possibles aux échecs, un nombre qui frôle l’infini (1040). La scène est tournée au Marshall Chess Club de New York (cf. photo 2), l’un des plus anciens clubs d’échecs des États-Unis, qui compta parmi ses membres illustres Marcel Duchamp et Bobby Fischer. En préambule à cette scène, une voix off introduit le problème du calcul du nombre de coups d’échecs possibles ; elle est filmée depuis une petite pièce noir et blanc.
La scène en tant que telle constitue la séquence d’ouverture du film et permet de présenter le piano à échecs. On m’y voit jouer les neuf premiers coups de la partie face au grand maître Leonid Youdassine ; nous sommes accompagnés par neuf musiciens cordes et entourés d’une vingtaine de retraités joueurs d’échecs. La scène est filmée en un travelling de dix minutes.
La deuxième partie du triptyque (milieu de partie) s’ouvre sur une voix-off (toujours tournée dans le même espace noir et blanc) qui s’interroge sur le moyen de compter les étoiles dans le ciel. La scène se passe sur le mont Saint Helens (cf. photo 3) dans l’État de Washington. Il s’agit d’un volcan en activité dont la dernière éruption remonte à 1980 et a laissé de profondes marques dans le paysage alentour : la végétation est rare et le sol est jonché de troncs carbonisés, couchés par le souffle de l’explosion. Dans cette séquence, j’installe mon propre observatoire, une construction personnelle pour une personne, au bord du cratère fumant du Mont Saint Helens.
La dernière scène, ou fin de partie, commence après une voix off (émanant toujours de la même pièce noir et blanc) expliquant pourquoi il est impossible d’accorder parfaitement un piano, car la théorie de la musique s’appuie sur une base faussée (en raison du comma pythagoricien). Dans cette scène, on me voit au milieu d’un paysage rude et désertique ponctué de collines ondulantes, en train de pousser une voiture remplie de matériaux de construction destinés à bâtir une petite maison d’ermite (cf. photo 4). À un endroit donné, je construis cette maison et j’y pénètre ; on reconnaît alors la pièce où était filmée la voix off. Une fois à l’intérieur, je m’assieds, tandis que la musique et la partie d’échec prennent fin. La partie se termine par un pat, notion que j’explique brièvement. Le plan suivant est tourné en extérieur : la caméra s’élève lentement (depuis un hélicoptère), jusqu’à laisser apparaître la faille de San Andrea (cf. photo 5).
Il s’agit d’une faille active à la jonction des plaques pacifique et nord-américaine, qui est responsable de la plupart des tremblements de terre en Californie et devrait provoquer un séisme majeur (surnommé « the Big One ») dans les quarante ans à venir.
Aux échecs, le pat symbolise un équilibre éternel ; c’est en cela qu’il est lié à l’équilibre temporaire des plaques tectoniques qui s’affrontent.
J’ai commencé à travailler à ce projet pendant l’été 2007 et l’ai achevé au printemps 2009.
Guido van der Werve